En France, plus de 11 millions de personnes soutiennent un proche au quotidien. Parent âgé, conjoint malade, enfant handicapé… Six sur dix travaillent encore. Un tiers néglige sa santé. Un sur cinq frôle le burn-out. Derrière ces chiffres, la réalité : fatigue, isolement, responsabilités sans fin. Une vie qui se rétrécit.
Le piège du burn-out se referme souvent à cause de croyances bien ancrées. Six idées reçues, en particulier, reviennent dans les témoignages, les consultations, les groupes de parole. Elles isolent, elles culpabilisent, elles usent. Pour chacune, des solutions existent. Encore faut-il oser les envisager.
1. “Je peux tout gérer seul”
L'illusion de tout contrôler, de porter seul la charge, pousse à l'épuisement. Beaucoup d'aidants s'interdisent de déléguer, pensant que personne ne saura faire “aussi bien”. Cette posture, nourrie par le devoir ou l'amour, s'avère intenable. Accepter de partager, même partiellement, réduit la charge mentale. Les relais existent : proches, intervenants à domicile, aides ponctuelles. Déléguer, ce n'est ni abandonner, ni faillir.
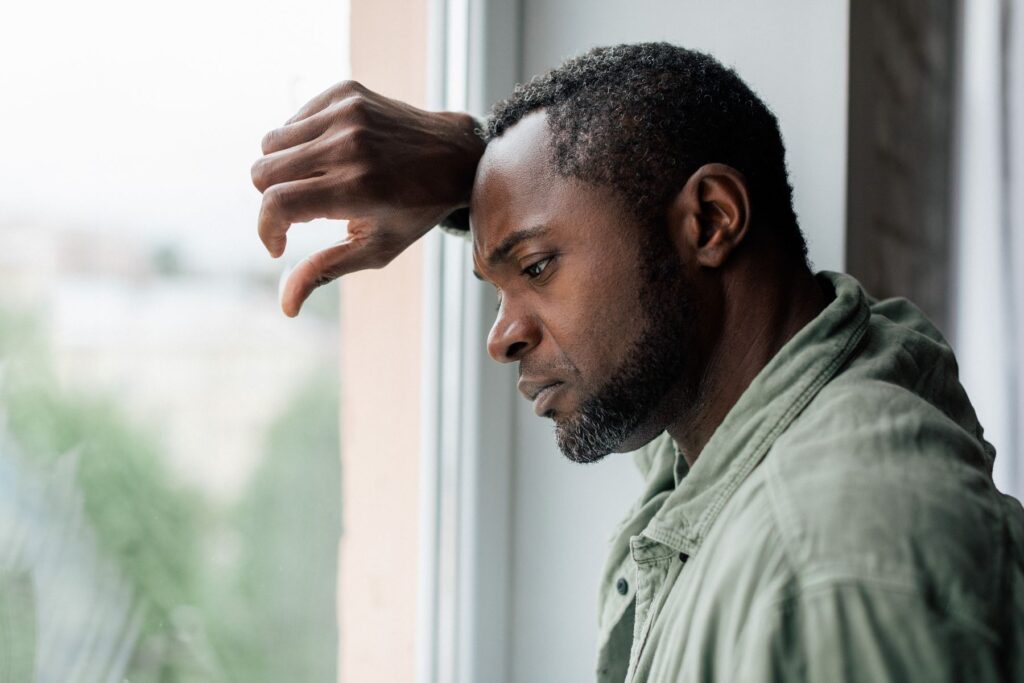
2. “Demander de l'aide, c'est avouer sa faiblesse”
La peur d'être jugé, l'angoisse du regard des autres, l'impression de déranger : autant de freins à la demande d'aide. Pourtant, aucun humain ne tient indéfiniment sans soutien. Oser solliciter l'entourage, faire appel à des associations, consulter un professionnel, c'est aussi prendre soin de la relation aidant-aidé. Les groupes de parole, les cafés des aidants, les plateformes d'écoute offrent un espace sans jugement.
LIRE AUSSI : Charge mentale des aidants : des clés pour dialoguer et mieux s’entourer
3. “Mon repos passe après, c'est secondaire”
Beaucoup d'aidants sacrifient loisirs, sorties, sommeil, parfois jusqu'à l'épuisement. La croyance que le repos est un luxe ou une fuite s'enracine. En réalité, le répit est vital. Prendre une pause, partir quelques heures ou quelques jours, revient à recharger ses batteries. Le droit au répit existe, financé jusqu'à 500 euros par an pour certains dispositifs. Accueils de jour, séjours temporaires, aides à domicile : autant de solutions à explorer.
4. “Je n'ai pas le droit de faillir, il faut être parfait”
L'exigence de perfection, la mesure de soi à l'aune de l'abnégation, entretiennent la culpabilité et l'épuisement. Mais nul n'est infaillible. Reconnaître ses limites, accepter ses erreurs, se traiter avec bienveillance, c'est aussi garantir un accompagnement de qualité sur la durée. Le perfectionnisme n'a pas sa place dans le rôle d'aidant : la bienveillance, envers soi-même, prime.
5. “Je suis seul à vivre cela”
L'impression d'isolement, renforcée par le silence de l'entourage ou des institutions, pèse lourd. Pourtant, des millions d'aidants traversent les mêmes épreuves. Partager, témoigner, rejoindre un groupe de soutien, permet de rompre la solitude. La Journée nationale des aidants, chaque 6 octobre, rappelle l'ampleur du phénomène.
6. “L'impact financier, c'est secondaire”
Les frais liés à la perte d'autonomie s'accumulent : soins, matériel, adaptations, transports, parfois réduction ou arrêt du travail. Sous-estimer le stress financier aggrave l'épuisement. Des aides existent : Allocation Journalière du Proche Aidant (AJPA), APA, PCH, congé proche aidant, accompagnement par les CCAS[2] ou associations spécialisées. S'informer, anticiper, alléger la pression budgétaire : un levier concret pour préserver sa santé.

LIRE AUSSI : Aidants familiaux à plein temps : que reste-t-il quand on arrive à la retraite ?
Repérer et prévenir l'épuisement : outils et dispositifs
La prévention commence par l'écoute de soi. L'échelle de Zarit, simple questionnaire, aide à mesurer sa charge émotionnelle. Dès les premiers signaux : fatigue persistante, irritabilité, troubles du sommeil, perte d'intérêt, il faut consulter un professionnel. La santé de l'aidant conditionne celle du proche aidé. Ne pas attendre l'effondrement pour agir.
Les solutions existent, même si elles restent parfois difficiles d'accès :
- Le congé de proche aidant, l'AJPA, l'aide au répit permettent de souffler.
- Les associations, comme France Alzheimer, Unafam, ARSLA, proposent groupes de parole, conseils, dispositifs de relais.
- Les plateformes téléphoniques et numériques (0 800 360 360) offrent écoute et orientation 24h/24.
- Les services d'aide à domicile[3], d'accueil temporaire, les EHPAD restent des options à mettre en balance, selon la situation et les souhaits du proche accompagné.
Questions pratiques : s'orienter, s'entourer
Comment mesurer son niveau de charge ?
L'échelle de Zarit (ou mini-Zarit) propose 22 questions. Un score supérieur à 41 indique une charge modérée à sévère. Cet outil, utilisé par de nombreux professionnels, aide à objectiver l'épuisement et à déclencher une alerte.
Que faire quand la fatigue s'installe ?
- Parler à son médecin traitant, évoquer son rôle d'aidant, demander un accompagnement adapté.
- Solliciter un bilan auprès d'une Maison des Aidants ou d'une association spécialisée.
- Informer son employeur, activer le congé de proche aidant si besoin.
- Organiser une réunion familiale pour répartir les tâches et chercher des relais.
Quels relais concrets existent ?
- Aide à domicile[3] (auxiliaire de vie[4], infirmiers), portage de repas, téléassistance.
- Accueil de jour pour la personne aidée, séjour temporaire en résidence ou EHPAD.
- Groupes de parole, ateliers, plateformes d'écoute en ligne ou par téléphone.
- Associations et CCAS[2] pour les démarches administratives et l'accès aux droits.
Changer de regard, préserver l'équilibre
Être aidant familial ne relève pas de la vocation mais d'un engagement, souvent subi, parfois choisi, toujours intense. Renoncer à l'illusion de toute-puissance, refuser la solitude, reconnaître la nécessité du répit : autant de pas pour préserver sa santé et celle de l'autre. Le burn-out n'est pas une fatalité. Les dispositifs, les collectifs, les nouvelles formes de solidarité progressent. L'équilibre reste fragile, l'information, le partage et la prévention sont les seules armes efficaces. Ceux qui aident méritent d'être accompagnés, reconnus, protégés. La poussière peut attendre, la fatigue non.






Commentaires (8)
Clément
17 Oct 2025Quand est-ce que les grands directeurs et tout petits chefs de service qui ne servent à rien seront ils virés et donc l ‘ argent ira vraiment pour le bien être des personnes et pourront finir leur vie dans la douceur.
Gala
16 Oct 2025Non, malheureusement cela ne sont pas que des idées reçues. Surtout en milieu rural, les accepter c’est faire face au manque de structures, à la complexité des dossiers, au manque de personnel,.. l’isolement est un refuge qui maintient un confort de vie quotidienne mais quand la personne aidée décéde rien n’est mis en place pour le conjoint survivant qui doit se remettre de sa prise d’otage. Stop aux dispositifs occasinnels beaucoup plus frustrants qu’utiles qui ne servent que de promotion aux politiques qui sont bien contents de ne pas avoir à gérer les cas.
Compte tenu du contexte économique, il va peut-être falloir réapprendre a s’occuper les uns des autres en famille plutôt qu’attendre la bonté d’état qui préfère de loin la jeunesse et les cas sociaux aux vieux handicapés qui ne manifestent pas et ne pas se leurrer cela n’a aucun effet bénéfique contrairement a tout ce que l’on nous fait croire
Simon pascale
16 Oct 2025Bonjour. Mon mari a fait 2 avc grave en 2018. Nous sommes retraites. Je m occupe de mon mari ( à domicile) depuis 7 ans. Une personne vient une après-midi par semaine et 4 fois par semaine repas par le ccas.
Je ne quitte pas mon mari, suis à son » service » je gère tout je réparé tout je dois penser à tout. Je suis sa secrétaire sa pousseuse de fauteuil, son aide perpétuelle. C’est difficile tout! Physiquement nerveusement moralement.
Raineau
16 Oct 2025Etre aidant c’est subir les aleas des structures de ’’ service a la personne’’ qui trop souvent font defaut et aggrave les situations des maladés .. comment se fait il que ces structures ne soient pas meux encadrees… sinon du busness….attribuant des taches aupres des malades ne conna issent rien du dossier….ces personnes non formees ,,arrivent ne connaissent pas les gestes appropries du maniement du leve mala du lit medicalise, sans gants ni protection etc.. change a l’envers .. impossible de se permettre un conseil sans avoir de reflexion desagreable du genre.. vs avez de la chance qu’on soit la..cette personne de ’’couleur’’ ressente une sorte de mepris par leur tache peu facile mais d’emblee s’impose.. aux personnes vulnerables .. deja anxieuses.,,,,!!!.honte a ses structures se disant bienveillantes .. sont tres loin du respect attendu si ce n’est le commerce!!!!.. comment expliquer le burn out l’ irreguliralite du quotidien.. des horaires du toilette fantaisistes..les w,e .. se voir supprime la prestation sans etre averti,,attendre au lit … souille..pourquoi des verifications inopinees n’ont pas lieu,,,,?? La selection infaillible… resultant d’un service de qualite .. des economies a la clef .. ar ces services se gavent au detriment de la societe des ’’sans voix’’ trop d’incapables se refugient dans ce crenau porteur des ’’vieux’’ sans avoir une formations tructurante ,, on ne s’improvise pas.. auxilliaire de vie alors qu’on a aider sa grand mere.. tant s’e faut !! Ses structures’’’’sans scrupules otenant des agrements a tout va… trop facile… des economies a faire pour le gouvernement .. cherchez .. le bien fonde de ces infos donnees par des personnes de 80 et 92 ans subissant le triste quotidien de ces’’’ fauteuils trop confortables’’occupes par des inconscients loin de la base du reel travail trop souvent bacle.un peu de respect trop loin de la bienveillance ..parfois limite proprete.. des gestes et paroles inutiles inconsideres seule une adaptation specifique justifiee et controlable surtout ameliorerait l’echange a tous les niveaux… et le’s economies bien presentes..associe au confort considerable des malades et a la fois des aidants obliges par necessite de former .. double peine..??! Merci pour votre lecture … sans avoir exagere la situation.. ne recherchant qu’ ameliorer uniquement.